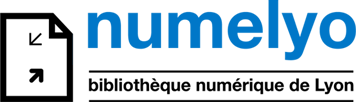La Bicyclette
Trois mots célèbres, modifiés, à peine conteraient ses destinées : Hier, qu'était-elle? Rien. Qu'est-elle aujourd'hui? Quelque chose. Que sera-t-elle demain? Davantage.
Son royaume en formation s'étend tous les jours. Elle est de tous les mondes : le grand, le moyen et le petit. Il n'est frontière pour l'arrêter, principauté où elle ne compte un sujet, retraite où elle ne pénètre. Elle est entrée dans la boutique, dans l'atelier et sinon dans le salon, du moins dans l'antichambre.
Elle a franchi le seuil des plus sévères maisons et des meilleures. Elle a subjugué la plus capricieuse, la plus mobile des puissances, la mode. Elle a tenté la femme. La Faculté l'ordonne ; le percepteur la poursuit.
Elle a ses fidèles et ses infidèles, ses adorateurs et ses détracteurs. Elle a ses gloires, ses deuils, sa tradition. Elle a enfin sa presse spéciale, une presse multicolore où se reflètent ses qualités et ses défauts, les défauts et les qualités de la jeunesse.
C'est qu'en effet, la vélocipédie n'est encore qu'adolescente. Je parle de sa période historique. La période antérieure, celle des origines premières, est obscure. Des érudits et des archéologues auraient reconnu, incrustées sur des bas-reliefs babyloniens ou sur des pharaoniques hypogées, des formes étranges d'homme glissant sur des roues, de suggestives images annonçant la silhouette du Cycle. De loin en loin, on retrouverait la trace, de l'idée propagée à travers les âges, transmise de race en race, de génération en génération pour s'épanouir en cette fin de siècle.
La vérité est que si l'on remonte de trente ans seulement en arrière, l'ombre commence avec la légende.
Nous savons qu'aux alentours de 1820, un appareil singulier circulait à Munich ou à Carlsruhe. Deux roues que reliait par le haut une barre transversale: sur cette barre, une selle; sur cette selle, un cavalier qui progressait en frappant le sol d'un mouvement rythmique des pieds : c'était la draisienne, - du nom de l'inventeur, le baron Drais - qui partait pour son tour d'Europe. Elle cheminait à petites étapes. On la raillait plus qu'on ne la louait; on la remarquait; elle, indifférente, suivait sa voie prédestinée. Elle passa la frontière. Un beau jour, elle faisait halte à Paris... C'est là qu'eut lieu l'événement décisif : sa rencontre avec les Michaux père et fils.
Ils s'éprirent de l'étrangère et ils lui firent don d'un talisman qui devait lui permettre d'achever s'appelle la pédale. Le vélocipède est créé.
Il est laid, bizarrement laid. Oui. Ce véhicule d'alors était une chose bien rudimentaire encore, bien mal plaisante à regarder ou à entendre. Recroquevillé sur lui-même, tordu en quatre, le nez au ras du gouvernail - un monument de fer ou de bronze, ce gouvernail, où se profilaient des têtes de bête, de faune ou de nymphe, que sais-je, - les genoux au ras du menton, l'homme chevauchant cette monture pittoresque et sonore offrait bien le spectacle le plus caricatural. Mais nul piéton ne lui résistait; le cheval de fiacre avait trouvé un rival. Est-ce sa vitesse relative qui lui valut le succès, ou n'est-ce pas son étrangeté même? Il n'importe. Le fait est qu'en dépit des quolibets, le nouveau « dada » vécut. Paris s'en moqua, mais s'en engoua. Les grands boulevards s'en égayèrent : Il eut son heure de vogue. Là tempête de 70, momentanément, l'emporta.
Mais il avait passé la Manche. Déjà l'Angleterre était devenue sa patrie d'adoption. Il n'y devait plus périr. Sur cette terre hospitalière au sport et à l'exil, le sport exilé réalisa de rapides progrès. Les ingénieurs, les mécaniciens se sont emparés de l'invention du père Michaux et ils l'ont perfectionnée. Il y avait beaucoup à faire pour transformer cette masse brute de métal et de bois en un objet d'élégance, ce boneshaker (secoueur d'os) en un coursier de vol et de paresse. Mais ces premiers pionniers avaient la foi. L'acier et le caoutchouc prirent la place du bois et du fer dans la carcasse du monstre. Il s'allégea, il s'éleva. Ses lignes se modifièrent, ses courbes s'amollirent et voici que, par une insensible et pourtant brève métamorphose, de l'archaïque enveloppe première se dégagea, papillon de cette chrysalide, l'aérien bicycle. Et aussitôt de croître et de multiplier et de graviter autour de lui, au-dessous de lui, prince du jour, un peuple hétérogène et baroque, cycles, tricycles de toute forme, de toute taille, de tout poids et de tout dessin. .Ils progressaient avec lui; même ils gagnaient sur lui déjà plus proche qu'eux du point de sa perfection: L'année 1885 le vit à son apogée.
Ce fut une heure charmante où l'ignorance du public, ses craintes faisaient au culte nouveau et à nous, ses initiés et ses pratiquants, comme un cercle de solitude. Une pointe de danger ajoutait un attrait à ce jeu rare, relevait la qualité de notre plaisir, plaisir d'orgueil et d'égoïsme. Un sport était né, gracieux, hardi, émouvant. Mais ce n'était pourtant qu'un sport dont le bicycle était l'outil d'agrément, de luxe, d'élite, c'est-à-dire d'exception et qui devait succomber.
Ce que n'avait pas su accomplir le bicycle, la bicyclette, moins séduisante d'aspect, moins aristocratique d'allure, plus terre à terre, la plébéienne bicyclette l'a tout naturellement accompli : elle a popularisé l'usage du cycle. Parmi la foule des suivantes, cortège de gloire du Grand-Bi, - C'est ainsi que ses familiers dé- le tour du monde et sa conquête. Ce talisman signaient le Bicycle - une entre autres, et tout de suite, se fait remarquer, qui pourtant ne paye guère de mine. Est-ce une résurrection ou une revanche? Ces roues égales, ce corps bas et allongé, nous les avons déjà vus. Cette aventurière n'est pas une inconnue. C'est le boneshaker qui revient dégrossi, rajeuni, féminisé, puis-je dire, mais armé, prêt pour la lutte. C'est la bicyclette. Entre elle et le bicycle, le duel bientôt s'engage, court, décisif. La bicyclette triompha en vertu de la loi de sélection, parce qu'elle était la meilleure : la chose selon le coeur et les besoins modernes. Chassé de la route, défait dans l'arène, le grand bicycle disparaît.
Les instruments précurseurs de la race nouvelle, l'Extraordinaire, le Facile, le Rationnel, la Girafe, le Kanguroo, et les derniers survivants de la race vaincue, toutes ces créations hybrides d'une époque transitoire, disparaissent. Le tricycle se fait 1res rare. Sur un royaume nivelé et unifié la bicyclette va régner seule.
Le secours qui lui avait donné la victoire, l'invention qui, une fois encore, allait révolutionner notre microcosme, était venue d'Irlande. - Vers 1889, un vétérinaire de Belfast, Dunlop, avait imaginé le « Pneumatique ».
Souveraine absolue, internationale vraiment, de par ses multiples bienfaiteurs, la bicyclette ne demeura pas stationnaire. N'ayant plus de concurrence immédiate à redouter, elle se prit elle-même pour objet de son effort. De progrès en progrès, elle est devenue l'instrument par quoi l'homme, si mal doué sous le rapport de la vitesse, s'égale sur le plus bref parcours à l'animal le plus rapide, le cheval de course (W. Edwards n'a-t-il pas couru le mille anglais, 1609 mètres, dans le temps merveilleux de 1 m. 34 s. 2/5), cependant que, sur les longues distances, il ne le cède qu'à la vapeur (témoin les 829 kil 498 m. de Huret en vingt-quatre heures). Elle est devenue ce que nous la voyons aujourd'hui et qui durera combien de jours ?
Il est, en effet, difficile de tracer la limite entre le présent et l'avenir, tant est rapide l'évolution qui l'emporte. Déjà elle s'est constituée le centre d'un petit univers. Elle a acclimaté sur notre sol un commerce très lucratif. Elle y a créé de toutes pièces une industrie nationale de haute importance, et à côté de celle-là, une infinité de petites industries accessoires. Longtemps tributaire de l'étranger pour la quasi-totalité de sa consommation, qui est énorme, notre pays s'est mis à l'oeuvre. Des usines se sont fondées qui rivalisent avec les meilleures fabrications étrangères. A cette heure, la production de la France suffit à la majeure partie de ses besoins et contribue à la satisfaction de ceux d'autrui. Je n'alourdirai pas de chiffres cette esquisse. Mais un coup-d'oeil jeté sur la statistique, vraie quelquefois, montrerait, plus éloquemment que toute parole, quelle, place a été prise sur notre marché, tant intérieur qu'extérieur, par la vélocipédie. Combien de bras elle occupe, combien de capitaux elle remue, quel mouvement d'affaires elle provoque ! Elle s'est faufilée partout. Il n'est pas jusqu'à notre organisation militaire où elle n'ait réussi à se faire sa place. Elle assure à l'armée un efficace service d'estafettes, et dans ce domaine si bien clos, nul doute que le temps ne lui découvre des modes d'emploi imprévus. Ne vient-on pas de voir l'aérostation solliciter son concours ?
C'est tout un peuple d'ingénieurs, de mécaniciens, de techniciens qui s'est voué à son progrès. Aussi, chaque jour, se révèle-t-elle sous quelque aspect nouveau, et c'était récemment l'invention, à Munich (son point de départ, mais. quel chemin depuis parcouru !) d'une bicyclette à pétrole, automobile. On nous prophétise, que dis-je, on nous décrit l'aérocycle (2) qui résoudrait le problème de la navigation aérienne. Nous avons l'aquacycle ; un journal de Chicago exhibe l'image d'un patin vélocipédique; le skacycle; un journal de Paris affirme qu'une bicyclette construite ad hoc, l'ice-cycle, fera partie de la prochaine expédition vers les mers glacées du Nord. Le cycle va tenter le ciel ; il a tenté l'onde; il a conquis la terre; le pôle l'attire. Ne disions-nous pas qu'il était parti pour accomplir le tour du monde ?
Cette prodigieuse fortune a étonné, froissé, même scandalisé bien des gens. Elle est pourtant la chose la plus naturelle du monde si l'on y daigne réfléchir.
Le triomphe de la bicyclette n'est point le fait du hasard. Elle est venue au jour qu'il a fallu. L'à-propos, n'est-ce pas les trois quarts du succès ? Il explique et justifie tout le sien. Son avènement correspond à un mouvement qu'on a très exactement qualifié « une Renaissance physique ».
A l'individu cérébralisé à outrance, à l'individu incarcéré par la profession, détérioré par le milieu, deux remèdes s'imposent : l'air, l'exercice l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Le gymnase et la salle d'armes lui en proposent un, sous les espèces d'un labeur noble, passionnant, intelligent, mais, pour cela, très fatigant à la l'acuité dont nous voulons le repos. La marche nous offre un peu de l'un et un peu de l'autre, mais sous quelle forme monotone ! Le cheval et mieux encore l'aviron et le patin les lui présentent tous deux unis. Mais dans quelles conditions ou à quel prix! La bicyclette, alors, est venue qui nous a donné l'air et l'exercice ensemble, qui a mis la campagne à la portée de la ville, qui facilite, provoque le quotidien envolement hors de l'étude obscure, de l'atelier puant, du bureau tyrannique. (Et regrettons que notre industrie, accaparée par le riche, n'ait pas encore trouvé le temps de songer au pauvre, à cette innombrable clientèle qui attend sa machine à très bon marché, même grossière pourvu qu'elle roule.)
Les joies que l'athlète trouve dans la lutte peuvent être inintelligibles à qui ne les a ressenties ; mais je parle du plaisir à la portée de tous : celui du touriste, du promeneur, de quiconque s'est aventuré sur deux roues, le vôtre ou le mien. II doit être bien séduisant ce plaisir, puisqu'il nous en fait négliger tant d'autres ! Le chemin du gymnase presque oublié, le manège dans le marasme, la salle d'armes moins bruyante, la rivière désertée, tout cela est son oeuvre indirecte, involontaire, - mais certaine. De là un sentiment de jalousie des vieux sports vénérables à l'endroit de l'intruse. Le temps leur enseignera tout le parti qu'ils peuvent tirer du véhicule nouveau. Plus sages ou mieux instruits, ils solliciteront son alliance Maintenant, la colère les aveugle et ils ne prennent pas garde qu'en dépréciant la bicyclette ils déprécient l'homme, car la bicyclette, n'est-ce pas l'homme? même, C'est là son charme et son secret et dans ce charme est le danger. Ailleurs, la cessation du plaisir dans l'exercice nous avertit du moment précis où cesse l'exercice. Ici, la fatigue ne se fait pas aussi clairement sentir , elle reste mêlée de volupté, se fond en une griserie de vitesse. On est tenté de dépasser la mesure et, de fait, on la dépasse. Mais le coupable c'est nous, non la machine. Elle n'est, au pis, que notre complice. Pour notre mal, quelquefois, pour notre bien plus souvent, elle est partie intégrante de notre individualité. Elle l'augmente ou la renouvelle.
Par elle l'individu, affranchi une heure du joug professionnel, retrouve conscience de lui-même, de son moi oblitéré au frottement de tant de forces étrangères, hostiles : le civilisé reprend contact avec la nature et avec sa nature. Le sédentaire sent se réveiller en lui le nomade ancestral. La bicyclette mêle un peu d'aventure et de poésie à notre vie si prosaïquement réglée. Nous lui devons l'illusion, mieux encore, la sensation de la liberté. Au contemplatif comme à l'énergique elle est dictame : car elle est l'action faite rêve.
Dans un frisson d'acier, parmi le décor changeant des calmes paysages, parmi la fuite étonnée des choses, la vivante machine glisse, vole.