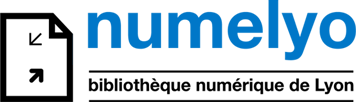Causerie
Lyon, 5 janvier.
Tel qu'à sa mort, pour la dernière fois, Un beau cygne soupire et de sa douce voix, De sa voix, qui bientôt lui doit être ravie, Chante, avant de partir, ses adieux à la vie !
Ces beaux vers d'André Chénier vibraient en ma mémoire, hier soir, au Grand- Théâtre, pendant le tableau de la Conciergerie, où l'intrépide et doux poète chantait à l'aube naissante du jour où, pour lui, se dressait la guillotine, sa touchante élégie de la Jeune Captive...
Il n'est peut-être pas, dans toute l'histoire de la Révolution, de figure plus séduisante et plus pure que celle d'André Chénier, mort sur l'échafaud à trente-deux ans, le 7 thermidor, deux jours avant la chute : des hideux terroristes dont la haine trancha dans sa fleur le noble génie qui s'était donné cette devise :
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques !
Né à Constantinople d'une mère grecque et d'un père français, fils littéraire de Théocrite et de Tibulle, Chénier apporta aux lettres françaises, avec la forme exquise des poètes antiques de l'Anthologie, la philosophie et les aspirations de son siècle. Au début de la Révolution, son âme généreuse avait salué d'hommages lyriques l'aurore radieuse qui se levait sur l'humanité. Mais plus tard, aux heures douteuses et sanglantes, quand l'héroïsme révolutionnaire se fut transporté tout entier, et sublime, à la frontière, laissant l'intérieur au règne de la délation et de la guillotine, le poète abandonna les élégies pleines de grâce et les fraîches idylles pour marquer du fouet de la satire les Robespierre, les Fouquier-Tinville et les Marat.
Je veux qu'on dise, un jour, écrivait-il en 1793, en pleine Terreur : Un nommé André Chénier fut un des cinq ou six que ni la frénésie générale ni la crainte ne purent engager à ployer le genou devant des assassins couronnés et à s'asseoir à la table où l'on boit le sang des hommes.
D'autres phrases pareilles, des vers plus courageux encore, et enfin l'ode fameuse à Charlotte Corday, en réponse à l'hymne infâme publiée dans le Moniteur à la gloire de Marat, le désignèrent aux pourvoyeurs de la mort. Jeté dans les cachots de St-Lazare, il y resta quatre mois et vingt jours. C'est là qu'il connut Madeleine de Coigny, la « Jeune Captive », qui fut sa dernière illusion d'homme et de poète, car dans la prison même elle en aimait un autre à l'insu de Chénier. Peut-être la Terreur agonisante eût-elle oublié le détenu dans sa geôle, si une démarche imprudente ne l'eût rappelé à Fouquier-Tinville. Le 7 thermidor à neuf heures du matin, André comparut avec vingt-sept personnes, dont son ami le poète Roucher, devant l'accusateur public. Il monta à l'échafaud le même jour, à six heures du soir, par un splendide soleil de juillet, dernier salut de la nature à cet homme si charmant, à ce poète qui la chanta si bien, à cette âme si parfaitement belle...
Tel est le héros que M. Giordano un musicien italien qui a tout juste l'âge de Chénier a voulu faire revivre dans son drame lyrique, parmi les tableaux prestigieux de l'époque révolutionnaire. Périlleuse tentative certes, mais le hasard n'était-il pas beau à courir?
Le compositeur en a triomphé grâce à des dons naturels rares : l'intelligence du théâtre, la flamme juvénile et claire, le sens de la vie dramatique et aussi par une précocité de science orchestrale qu'on n'attendait pas de sa jeune lyre. Son oeuvre est d'un courant rapide et entraînant, d'une couleur éclatante et souple, où se peignent les aspects opposés de scènes diverses, tour à tour légères et poignantes, délicates et grandioses. Par instants, il semble même qu'il y palpite quelque chose de la fougue révolutionnaire.
M. Giordano a d'ailleurs été servi par une mise en scène incomparable, exacte comme une gravure du temps, mouvementée comme la vie même, par où M. Vizentini vient d'affirmer une fois de plus sa maîtrise. Le spectacle seul suffirait à attirer les foules. L'interprétation n'est pas moins à louer pour sa rare perfection. Mme de Nuovina a su plier son tempérament tragique, atténuer son âme ardente pour évoquer adorablement à nos yeux ravis, et traduire en purs accents à nos oreilles attentives le personnage de Madeleine de Coigny, d'abord « ingénue » spirituelle et moqueuse, puis jeune fille attendrie et enfin femme sublime s'offrant aux suprêmes sacrifices. Le poète, c'est M. Lubert, comédien émouvant, chanteur chaleureux, bref un artiste. Et l'excellent Beyle, et Hyacinthe et Mme d'Hasty et tout le monde ont tous eu leur part dans une victoire digne du sujet et de l'oeuvre.