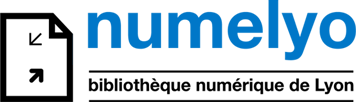Lohengrin
Bien que tout ait été dit, récemment, dans la presse quotidienne de Lyon, sur l'uvre magistral de Richard Wagner, nous avons pensé que nous n'en devions pas moins réserver dans ces colonnes une place au gros évènement artistique du 26 février dernier, qui depuis cette soirée triomphale, fait courir tous les Lyonnais au Grand-Théâtre de Lyon, et, pour en mieux fixer le souvenir, nous lui avons consacré l'une de nos principales gravures représentant la belle scène du premier acte, où apparaît sur l'Escaut la nacelle qui porte le Chevalier au cygne, reproduction exacte de la mise en scène et du décor du Grand Théâtre.
C'est à Weimar que fût représenté pour la première fois, le 28 août 1850, l'opéra romantique de Wagner. Depuis lors, d'importants fragments interprétés dans les concerts avaient fait connaître au public français le caractère et les beautés de l'ouvrage, lorsque M. Lamoureux donna la pièce en entier à l'Eden-Thêâtre de Paris, le 3 mai 1887. Cette soirée n'eut malheureusement pas de lendemain, de turbulentes manifestations s'étant produites, sous couvert de patriotisme, qui motivèrent l'interdiction des représentations.
Les Lyonnais ont mieux été inspirés, et si, comme on le raconte, des tentatives hostiles, motivées sans doute par les incidents du voyage une impératrice allemande à Paris, ont failli se produire au cours des premières représentations, elles n'ont pas pu aboutir devant la très digne et très louable contenance d'un public bien décidé à pas mêle un patriotisme mal entendu à une question purement artistique.
C'est à la fameuse épopée de Parsifal et Titurel, dont l'auteur est Wolfram d'Eschenbach, l'un des plus célèbres minnesinger de la fin du XIIe siècle qu'est empruntée la légende qui a servi de thème à l'auteur de Lohengrin. Dans son poème, Wagner nous montre Elsa, princesse de Brabant, faussement accusée par l'ambitieux Frédéric de Telramund et la haineuse Ortrude, d'avoir tué son frère. Elle est défendue et sauvée par un chevalier inconnu qu'elle épouse en jurant de ne jamais lui demander son nom. Mais les perfides conseils d'Ortrude, femme de Telramund, jettent dans l'âme d'Elsa le doute et l'inquiétude. Pendant la veillée nuptiale, elle interroge son époux. Aussitôt le charme tombe, et le chevalier doit regagner sa mystérieuse patrie. Devant tous il se nomme; il est le fils de Parsifal, et Lohengrin est son nom. Il est un de ces soldats pieux qui, dans un burg inaccessible, gardent quelques gouttes du sang de Jésus-Christ et ne peuvent combattre, aimer sur terre, une fois leur secret dévoilé. Lohengrin s'éloigne donc ; mais, avant de partir, il rend à Elsa son frère, que l'enchanteresse Ortrude avait métamorphosé en cygne. Le traître Telramund a payé de sa vie.son odieuse dénonciation, et Ortrude, vaincue, pousse des cris de rage. Mais, de son côté, Elsa ne peut survivre à la perte de son bien-aimé, et elle succombe à sa douleur. Telle est en quelques mots la marche du livret, aussi remarquable par sa simplicité que par le grand nombre de situations dramatiques qu'il renferme. Au point de vue musical, les principes wagnériens ne sont pas encore, dans Lohengrin, appliqués avec rigueur. La musique, ici, n'est pas immolée sans miséricorde à la déclamation ; malgré l'importance nouvelle et l'intérêt constant de l'orchestre, la voix humaine est parfois respectée, et plusieurs personnages chantent parfois des duos, des trios et des churs ; l'uvre, en un mot, caractérise exactement la seconde manière du maître, et si elle contient en germe toutes les innovations qu'il a développées si rigoureusement dans ses uvres postérieures, nous y sommes loin encore du système poussé aux dernières limites.
« Il est impossible, a dit Liszt, dans une brochure écrite peu de temps après la représentation de Lohengrin, d'apprécier cet ouvrage avec justice si l'on veut y chercher l'ancienne facture d'opéra, les divisions accoutumées des morceaux de chant, la distribution reçue des airs, romances, soli et tutti, en un mot toute l'économie adoptée pour faire- valoir les chanteurs et les mélodies, dans une proportion souvent arbitraire en faveur des premiers. Wagner abjure solennellement toute prise en considération des exigences habituelles. A ses yeux, il n'y a pas de chanteurs, il n'y a que des rôles, si bien qu'il trouve parfaitement simple de faire garder le plus complet silence à une première cantatrice durant tout un acte, où sa présence, effectivement, nécessaire à la vraisemblance de la scène, ne doit être marquée que par un jeu muet, certainement aussi dédaigné, qu'inexécutable par toute diva italienne. »
Le compositeur a voulu que l'effet fût produit sur l'auditeur, non par telle phrase ou telle page, mais par l'ouvrage entier, et il y a complètement réussi. De là, l'impossibilité d'en extraire une mélodie, un fragment complet par lui-même, à moins de chanter toute une scène. Chaque acte est également admirable, à le consulter dans son ensemble ; le premier, avec les magnifiques récits du roi, l'entrée poétique et la prière d'Elsa, les adieux du chevalier à son cygne et le magistral quintette du duel ; le deuxième, avec la scène entre Ortrude et Frédéric, un peu allégée de ses longueurs ; la cantilène d'Elsa, rendue avec de si délicieuses intonations et de si fines demi-teintes par Mlle Janssen, la scène entre les deux femmes, la populaire marche des fiançailles ; le troisième acte enfin, avec la marche nuptiale, le cur des fiançailles, le splendide duo d'amour, le récit du Saint-Graal et les adieux de Lohengrin.
Le public lyonnais a fait à Lohengrin l'accueil que méritaient tant de richesses harmoniques, et à chaque représentation tous les actes se terminent par des manifestations enthousiastes. Nous avons dit plus haut le succès remporté par Mlle Janssen; celui de M. Massart (Lohengrin) a été également considérable ; il faut citer aussi M. Noté (Frédéric),- Mlle Bossy (Ortrude) et M. Bourgeois, superbe de prestance dans le personnage du roi d'Allemagne. Ajoutons que l'orchestre traduit la musique de Wagner d'une façon irréprochable, et que les churs sont à la hauteur de leur difficile tâche. Quant à .la mise en scène, avec son immense déploiement de figuration, la splendeur des costumes e t les décors à grand effet, elle ne laisse rien à désirer, le sympathique et très habile directeur de notre Grand-Théâtre, M. Poncet, n'ayant rien négligé pour triompher des difficultés matérielles d'une uvre aussi considérable ; le résultat obtenu l'a pleinement récompensé.