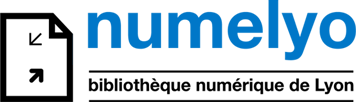Causerie Le Salon de Bellecour
La grande actualité du moment c'est notre Salon lyonnais. Je crois donc que mes lecteurs ne me sauront pas mauvais gré d'y consacrer cette chronique.
Il me faut confesser tout d'abord que l'Exposition de 1892 est plus terne encore que celle de 1891. L'an passé, nous avions tous, dans la presse, averti la Société des Beaux-Arts qu'elle s'engageait dans une voie fâcheuse ; qu'il lui fallait à tout prix tenter de reconquérir les maîtres parisiens qui, jadis, ne dédaignaient point notre Salon ; qu'il était indispensable surtout que messieurs les professeurs formant la majorité du jury eussent moins d'indulgence pour les bonnes petites croûtes de leurs élèves.
Cet appel n'a pas été entendu. L'impression de l'année dernière pouvait se résumer par un : « Holà! », il faut un : « Hélas! » pour rendre celle de celle année.
Loin de faire de nouveaux efforts pour attirer chez nous les peintres de Paris, la Société a supprimé ses correspondants parisiens. Cette intelligente mesure, combinée avec celle qui exclut du jury des récompenses tous les exposants étrangers, n'a pas manqué son effet. De là provient cette pénurie navrante de toiles signées par des noms célèbres, qui au moins offraient au public quelques compensations à la médiocrité de l'ensemble. Henner, Lefebvre, Harpignies, Jean-Paul Laurens, Puvis de Chavannes, Vollon et tant d'autres, nous envoyaient les années précédentes qui un tableau, qui une étude. Cette année, rien.
Quant à la production lyonnaise elle se maintient assez péniblement à son niveau accoutumé. Elle n'a fourni aucune de ces oeuvres d'une maîtrise incontestée qui affirment la vitalité d'une Ecole et assurent le succès d'une Exposition. Certes nous avons encore de bons peintres qui ont envoyé quelques bons tableaux. Mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur la cimaise pour constater qu'elle est encombrée par des toiles qu'on reléguait impitoyablement jadis à des hauteurs inaccessibles.
La peinture de jeunes filles envahit tout. C'est une, marée montante qui menace réellement de submerger l'art lyonnais. Par instants, dans cette Exposition, on se croirait au parloir d'un couvent, le jour de la distribution des prix, quand les parents se pressent pour admirer les oeuvres d'art de ces demoiselles. On ne s'imagine pas ce qu'il y a au Salon de fleurs des champs, de rêveries, de portraits d'ancêtres exécutés par de jeunes personnes aimant sans doute beaucoup leurs mères, et que je veux croire toutes charmantes, mais qui peignent avec acharnement et fécondité de détestables tableaux. Les familles devraient pourtant leur faire comprendre que cela peut nuire à leur établissement...
Quoiqu'il en soit, comme les professeurs qui dirigent fructueusement toutes ces vocations malheureuses font la pluie et le beau temps dans la Société, il en résulte que les toiles enfantines sont à Bellecour en effroyable majorité Il faut donc nous résigner à croire qu'il en est des Sociétés artistiques comme il en est souvent de la politique : plus ça change, plus c'est la même chose et même plus c'est mauvais.
Le Salon ne comporte pas moins de mille cinquante-deux numéros. Ce serait une besogne parfaitement fastidieuse que de passer en revue tout ce fatras. Si mes lecteurs le veulent bien, je me bornerai à leur signaler les envois, d'ailleurs assez clairsemés, qui laissent vraiment une impression d'art. Pour le reste tableaux de négociants en toiles peintes ou produits du « jeunefillisme » mieux vaut nen point parler.
Il y a quelques bonnes choses dans la salle d'entrée, notamment la scène de genre de M. Carpentier : Les mauvaises langues (n° 147). Dans une boutique d'épicier du village, des commères groupées autour du poêle, racontent de joyeux cancans en buvant leur tasse de « petit noir ». Cest amusant, finement observé, et d'une couleur qui enveloppe, bien les choses.
Le Portrait de M. Delaroche, par Frappa (n° 283), est parfait de ressemblance. Mais le peintre n'a pas su rendre tout le relief de cette figure énergique et loyale. Cela manque d'âme et de vie et l'ensemble est un peu froid. OEuvre très intéressante quand même, où l'on sent un peintre connaissant à fond son métier.
A voir encore un Intérieur, de Bail, un bon paysage de Mlle Dauvergne, une gracieuse étude de jeune fille de Mlle Kitty-Fournier et le Renard de Sallé (626), nature morte d'une facture sobre et sincère, comme tout ce que fait cet artiste consciencieux.
Dans la grande salle, côté Rhône, on remarque dès l'entrée, le grand tableau de Maxime Faivre : le Lever du Bébé, (265). Une jeune femme brune, délicieusement jolie, tient sur ses genoux, près du feu, un bébé blond auquel elle fait la toilette. Le foyer éclaire de chauds reflets la robe blanche de la maman et les chairs roses du petit. Le tout laisse une impression pénétrante et douce. Le Progrès Illustré reproduira dans un de ses prochains numéros cette belle toile, qui est assurément une des plus séduisantes du Salon.
M. Trévoux expose un vigoureux paysage, Campagne de Montbrison, peint en pleine pâte et d'une gamme chaleureuse. A coté une vue de l'Ile-Barbe, par Saint-Cyr Girier, aux colorations automnales, et une lumineuse rue de Village, par Gagliardini.
Jacques Martin est sorti de sa manière accoutumée pour peindre le portrait du vieux maître Vernay (453). Souhaitons qu'il n'y rentre pas, car cette dernière toile est excellente, tout simplement. C'est bien là le père Vernay avec son grand front pensif, son regard voilé, et sa longue barbe blanche. Tous mes compliments à l'artiste.
Le Marchand d'orviétan, de David Girin, ne me déplaît point. L'agencement des groupes est ingénieux, dans ce plein air où se joue le soleil. Le grand portrait de femme de Louis Appian est une toile agréable, très meublante pour un salon élégant. M. Iung nous montre des fleurs très enlevées et très vigoureuses; Isembart un Canal de Moulin dont les verdures tombent dans la grisaille ; Laissement, un cardinal rouge sur fond vert; Fantin-Latour, une danse de nymphes embrumée et parcheminée ; et Noirot, le Château de Cornillon (515), vieux burg qui se dresse tragiquement sur un rocher, dans un ciel gris robuste paysage brossé dans une note un peu rude, que je préfère à l'étude du même peintre (516), véritable débauche de lumière ardente et heurtée. Damoyeo et Japy ont chacun deux paysages où s'affirme leur talent consacré.
Frappa « fait recette » avec son Bureau de Nourrices. Le public s'arrête volontiers devant toutes ces appétissantes paysannes, devant ces goss qui crient avec de petites figures si drôles, devant ce médecin respectable et décoré qui inspecte avec scrupule les seins des candidates. Tout cela est traité avec le soin le plus minutieux, avec, la verve la plus spirituelle.
Un peintre lyonnais qui est tout à fait en progrès et dont la valeur émerge fort au-dessus de la banalité courante, c'est Balouzet. Son Etude en Suisse (35) donne une toute autre, impression de cette nature pittoresque que les grandes machines si bien léchées par M. Lortet à l'usage des épiciers. J'aime surtout les Quatre panneaux de Balouzet. Ce sont des marais vus à la nuit tombante, avec des ciels bas et des lointains violets. Il y a, dans ces études, un « faire » superbe et un sentiment de la nature qu'on ne saurait trop louer.
Dans la grande salle du côté Saône, il faut voir la fête de Carlina (358) de Hirsch, dont ce journal publie aujourd'hui même une très exacte reproduction ; de savoureuses asperges de Claude ; les Cerises de Cocquerel ; un Intérieur de ferme de Thurner (670) harmonieusement et largement peint ; le Ramasseur de pommas de terre de Beauverie, que je préfère à ses Bords du Lignon, grande page qui est un peu banale ; des OEufs sur le plat de Bail on en mangerait ! le Portrait de M. Nolot par Mlle Olivier, qui serait sans défauts graves, si l'excellent président du Conseil général n'avait pas cette pose, truculente et solennelle ; un petit paysage parisien, très fin et charmant dans ses tons gris, par Petillion (547) ; un Appian toujours papillotant et joli mais si artificiel ! ; un solide et très sincère Coucher du soleil à travers bois par Arlin et les Roses de Perrachon, d'un grand effet décoratif, mais si nacrées et si vaporeuses qu'elles n'ont vraiment plus rien de commun avec la réalité.
Le vaste paysage de Nozal, Un Orage sur l'étang de Saint-Quentin (519), vaut mieux qu'une simple mention. Cette nappe d'eau jaunâtre, fouettée par le vent et la pluie, est d'un artiste qui comprend et qui sait interpréter la nature.
Barriot est moins heureux que l'an passé. Ces deux envois Sous le Poirier et la Cueillette des haricots sont d'une facture toujours correcte et soucieuse du plein air, mais les personnages touchent à la mièvrerie. Que ce peintre, si distingué et si bien doué, prenne garde de ne pas tomber dans les paysans d'opéra-comique !
Reste maintenant à donner un coup d'oeil à la petite salle de sortie. C'est le réceptacle de toute une collection de choses tordantes et grotesques sur lesquelles il vaut mieux passer. Impossible pourtant de no pas voir un immense Orphèe, qui joue assez correctement au simili-Puvis de Chavannes.
Il y a quelques jolis envois dans les deux annexes réservées aux dessins. Frappa nous montre un adorable pastel aux chairs satinées et une de ces amusantes scènes de moinerie dans lesquelles il excelle comme aquarelliste. Mlle Anna Bilinska (729) expose une Petite Mendiante qui serait tout à fait exquise si la pose était moins apprêtée. Le fusain de M. Appian (715) est de premier ordre et très supérieur, comme d'ordinaire, à ses tableaux.
La sculpture compte un assez grand nombre d'envois. Deux seulement sont remarquables. Le Buste de Coysevox, par Fontan et la Soie, de Devaux. Voilà deux Lyonnais qui font honneur à l'art local. Le Coysevox de Fontan, est d'un fier modelé et saisissant de relief. Quant à la Soie, celte oeuvre d'un jeune m'a ravi. Elle est d'une grâce suprême, cette jeune femme au torse grec, qui s'enlève dans un mouvement si élégant et si juste...