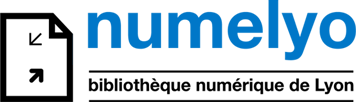Causerie
Le Midi vient de recevoir un coup bien rude... Le voilà découronné du prestige d'avoir donné le jour à une des plus « grosses » notoriétés littéraires de ce temps, à celui qui s'intitule modestement, devant ses intimes, « le premier écrivain du siècle », - comme s'il n'y avait pas les nommés Victor Hugo, Balzac, Musset et Renan pour marcher avant lui... A ce portrait vous avez, reconnu M. Emile Zola.
Eh bien, non, M. Zola n'est pas du Midi! Le rempart de Plassans n'est pas de Plassans. Il n'appartient point à cette phalange méridionale qui vint conquérir la France littéraire il y a quelque quarante ans. C'est le ventre de Paris qui enfanta le géant, - ainsi qu'il appert d'une déclaration solennelle faite par lui-même en un banquet récent, dont la date, désormais, demeurera célèbre. Pleurez Tartarins, Félibres et Cigaliers ! M. Zola est né à Paris, rue St-Joseph. M. Zola n'est pas du Midi !
Cette révélation sur le berceau du père de Nana cause un tapage énorme. Le Landerneau littéraire en est plein d'émoi, et la question du jour consiste à se demander pourquoi M. Zola a attendu si longtemps avant d'attacher à la couronne de Paris ce nouveau et glorieux fleuron. Des malins prétendent même qu'il ne faut voir là qu'un gros coup de réclame inédite imaginée par le copieux écrivain, lequel, comme on sait, aurait pu rendre des points à feu Barnum.
M. Zola, insinuent ces mauvaises langues, s'est demandé par quel stratagème il pourrait, une fois de plus, « épater » ses contemporains à la veille d'un scrutin académique. Et il aurait, par un trait de génie, imaginé cette flatterie suprême à l'adresse des Parisiens dont l'opinion a tant de poids sur celle de l'Académie... D'autres encore prétendent que le Maître a voulu simplement créer, sur sa naissance des légendes contradictoires, de manière à offrir avec Homère un point de ressemblance de plus.
Quoi qu'il en soit de ces explications diverses le fait est là. Et le Midi se voile la face ; et Paris, ébloui autant que charmé, se demande s'il doit croire à tant de bonheur...
Malgré tout, ce n'est pas encore cette fois que M. Zola entrera à l'Académie, bien qu'il manque à sa gloire. Même y entrera-t-il jamais ? On peut en douter. Les immortels sont gens têtus, et ils paraissent tout à fait décidés à écarter ce postulant indiscret de leur sein palmé de vert. Comme le vieux méridional qui mourut inconsolé de n'avoir jamais vu Carcassonne, l'historiographe des Rougon-Macquart décédera peut-être avant d'avoir jamais siégé sous la coupole « qu'académique on nomme ». Et il pourra faire inscrire sur sa tombe cette épitaphe renouvelée de Piron, mais au rebours : Ci-git Zola qui fut tout excepté académicien.
Car elles sont, paraît-il, d'une amertume singulière les déceptions du candidat recalé par l'Académie. Paul de Saint-Victor en mourut. L'auteur harmonieux des Deux Masques n'avait eu que deux voix. Le soir à dîner, chez Victor Hugo, il n'était déjà plus le même homme, tant ce coup l'avait frappé rudement. Pourtant il dit au père Hugo : J'ai eu votre voix. Cela me suifit pour être consolé de tout.
Et il souriait. Mais son sourire, au fond, était navré. Il languit quelques semaines encore : son coeur saignait et il mourut. Victor Hugo lui fit une oraison funèbre plus belle que toutes celles de Bossuet : C'est superbe, s'écria Renan. On dirait du Saint-Victor Hugo !
Le pauvre homme n'en était pas moins mort, tué par le refus des Quarante. En ce qui concerne M. Zola, ce dénouement fatal paraît heureusement conjuré. N'a-t-il point désormais, pour se consoler, ce précieux dictame : l'eau de Lourdes ?
N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir voler comme l'hirondelle, - sillonnant le bleu chemin de l'air
, dirait Théophile Gautier ? N'avez-vous point répété l'air mélancolique de la Salammbô de Reyer : Qui me donnera, colombes, vos ailes ?
Dans vos songes, parfois n'avez-vous pas goûté l'exquise sensation du « plus léger que l'air », d'une envolée impossible dans l'éther, au milieu des plaines vierges de l'empyrée, sous le regard des chastes étoiles ?
Voici que cette chimérique illusion revêt une apparence de réalité, grâce à M. Otto Lilienthal, un savant allemand, qui s'est construit des ailes de chauve-souris de quinze mètres carrés, et qui a pu, prenant son élan du sommet d'un grand rocher, planer horizontalement pendant près de trois cents mètres et atteindre doucement le sol.
Il y a loin, sans doute, de cette descente pataude aux coups d'ailes hardis dont la vision nous hante. C'est pourtant un commencement. Souvenez-vous des humbles origines de la bicyclette. Qui sait si l'aviation n'aura pas un essor aussi rapide ? Mais peut-être vaut-il mieux que l'humanité demeure rampante sur sa glèbe. Elle est si divisée contre elle-même qu'elle porterait la guerre jusque dans la paix des cieux. Et l'homme, sans doute, commettrait le suprême sacrilège d'ensanglanter l'azur...