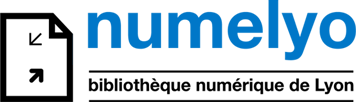Causerie La Comédie-Française est à Lyon. Je parlerai, dans la prochaine causerie, de l'ensemble des représentations qu'elle va nous donner. Pour aujourd'hui, je cède la plume à M. Alfred Barbou pour son intéressante monographie sur la maison de Molière. J. M.
La comédie-française.
Si, selon la poétique pensée d'un des fils de Victor Hugo, les maisons ont une âme, l'âme de Molière, certes, na point cessé d'habiter sa maison.
Depuis deux siècles il l'a quittée en apparence et s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'ajouter des chefs-duvre à ses chefs-d'uvre ; mais son esprit est resté vivant. Il anime encore ceux de ses enfants qui chaque soir, épris des grandeurs de l'art dramatique, nous aident à en comprendre les beautés et provoquent justement l'admiration de la foule.
La Comédie-Française est une gloire de notre nation; elle n'a cessé de tenir haut et ferme chez nous le drapeau des lettres. De quelque côté qu'on se tourne dans ce monde, elle apparaît avec un éclat indiscutable, une incontestable supériorité.
Aussi sommes-nous heureux de lui rendre hommage en publiant un certain nombre de portraits de ceux qui la composent. Cette galerie devra être conservée comme un document de l'histoire littéraire de notre époque.
Nous ne retracerons point les biographies de ces artistes qui sont connus de tous ; ces biographies seraient trop courtes et ne contiendraient pas assez d'éloges. Mais nous les encadrerons en quelque sorte dans une brève notice, résumant le passé, rappelant l'histoire de l'immortelle maison de Molière devenue la leur.
C'est de 1658, époque définitive du séjour de Molière à Paris, que date réellement la Comédie- Française quoiqu'on ne fasse dater sa fondation que de l'année 1680.
En 1658, ainsi que l'ont fait remarquer les nombreux historiens de l'illustre théâtre et entre autres le savant M. Bonassies, en 1658 Paris possédait deux troupes françaises permanentes.
Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, successeurs des Confrères de la Passion depuis la fin du XVIe siècle, siégeaient rue Mauconseil et rue Française, sur l'emplacement de l'ancienne Halle aux cuirs, démolie il y a une vingtaine d'années, et leur compagnie portait le titre de troupe royale. Leur théâtre interprétait principalement la tragédie.
La seconde troupe, formée au commencement du XVIIe siècle, occupait le théâtre du Marais, situé à l'hôtel d'Argent, au coin de la rue de la Poterie, près de la Grève, puis rue Michel-le- Comte et plus tard rue Vieille-du-Temple où il se trouvait en 1658. Il avait pris la spécialité des pièces à spectacle, des machines, comme on disait alors, qu'il était possible de monter sur sa scène relativement spacieuse.
Molière devint le chef d'une troisième troupe et, avec ses camarades, débuta devant le roi et la cour, dans la salle des Gardes, au Louvre, le 24 octobre 1658.
On joua Nicomède, de Corneille, puis, rapporte M. Bonassies dans son Histoire administrative, Molière, orateur de la troupe, demanda au jeune monarque, en un gracieux discours, la permission de jouer son Docteur amoureux.
Cette petite pièce obtint un vif succès et, le soir même, valut aux nouveaux comédiens l'autorisation de rester à Paris, de jouer alternativement, sur le théâtre du Petit-Bourbon, avec les comédiens italiens et de s'intituler Troupe de Monsieur, frère unique du roi, titre qui conférait à chacun des acteurs une pension de trois cents livres, - pension qui, il est vrai, ne fut jamais payée, ainsi que l'a remarqué La Grange, le second de Molière, dans son Registre, qui est le plus exact document du temps.
Molière s'installa immédiatement et sa faveur grandit de jour en jour avec ses succès.
La troupe se trouva obligée, en 1660, de quitter le Petit-Bourbon dont la grande salle allait être démolie pour faire place à la colonnade de Perrault.
Pris au dépourvu, Molière s'adressa au roi qui lui permit de jouer au Palais-Royal, dans l'ancien théâtre de Richelieu, bâti par Lemercier pour les représentations de Mirame. C'était la plus belle salle qui existât; cependant on l'avait abandonnée depuis longtemps.
C'est sur ce théâtre que Molière a donné presque tous ses chefs-duvre, mais sa troupe n'y devait pas rester et la Comédie devait déménager plus d'une fois encore, avant d'obtenir un local définitif.
En 1673, Louis XIV réunit la troupe de Molière et celle du Marais, pour n'en former qu'une, sous le nom de Troupe du roi. Mais il donna à Lulli la salle du Palais-Royal et plaça ses comédiens à l'hôtel Guénégaud, ou plutôt au jeu de paume dépendant de cet hôtel est situé rue Mazarine, - rue des Fossés-de-Nesles à cotte époque, - sur l'emplacement occupé aujourd'hui par un obscur passage qui conduit à la rue de Seine.
Bientôt, fait inoubliable, sur les pressantes requêtes du recteur du collège des Quatre- Nations, personnage important et grave, qui trouvait le voisinage de la Comédie dangereux pour ses chers élèves, le roi Très Catholique ordonna aux comédiens de choisir un autre emplacement.
Ceux-ci, alors, achetèrent le jeu de paume de l'Étoile, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, où ils bâtirent, sur les dessins, de d'Orbay, une salle qui passa en son temps pour une merveille et qui servit au spectacle depuis 1689 jusque en 1770.
A cette époque, la salle menaçant ruine, les comédiens du roi obtinrent la jouissance provisoire de la salle des Tuileries où ils jouèrent jusqu'en 1782.
Dans cette salle eut lieu, le 30 mars 1778, le couronnement du buste de Voltaire.
A la même époque, on construisait un autre théâtre qui s'appela depuis l'Odéon, et qui fut édifié sur l'emplacement de l'hôtel de Condé. La Comédie-Française s'y installa, mais ce premier Odéon brûla en 1799 et les comédiens français furent mis on possession de la salle qu'ils n'ont plus quittée depuis.
Le Théâtre-Français actuel fut commencé par le duc d'Orléans, en 1787, et terminé en 1790. Il était en principe destiné au spectacle dit des Variétés-Amusantes, qu'un ancien comédien, nommé Lécluse, avait créé rue de Bondy. Sa première décoration intérieure, due à l'architecte Louis, consistait en cinq rangs de balcons circulaires, soutenus par des colonnes d'ordre corinthien.
En 1799, lors de la réunion des deux troupes françaises sous le nom de Théâtre de la République, M. Moreau, chargé de la restauration de ce théâtre, réduisit de quelques pieds l'étendue de la salle et y créa quatre rangs de loges (outre les baignoires) soutenus par de fortes colonnes ioniques de quatre mètres de hauteur, qui donnaient à la salle un aspect régulier dans le style antique assez conforme au goût du temps.
En 1822, une nouvelle restauration fut entreprise par M. Fontaine, qui remplaça les grosses colonnes de M. Moreau, dont on avait reconnu les inconvénients, par de petites colonnes composées, très minces, ne gênant point les spectateurs. Cette ordonnance subsiste encore aujourd'hui, à de légères exceptions près.
Voici les principales mesures de cette salle, qui est sans contredit une des plus belles et une des plus commodes de Paris : Longueur de l'édifice, de la rue Richelieu à la cour du Palais-Royal 5Im Largeur totale 35m Longueur de la salle dans oeuvre 17m Largeur de la salle dans oeuvre (prise du fond des loges) 21,50 Longueur de la scène 24m Largeur de la scène intérieure 24.50 Largeur de la scène à l'avant-scène ..1*m Hauteur intérieure du parterre à la voûte 10,50
Durant toutes ces transformations que nous venons d'indiquer brièvement, à cause du peu de place dont nous disposons, la destinée de la Comédie-Française fut diverse et sa fortune eut des éclipses. Pendant tout le demi-siècle précédant la rénovation dramatique opérée par Voltaire, les bouffons italiens, les théâtres de la Foire mêmes n'eurent pas de peine à attirer chez eu le public, que ni acteurs éminents, ni oeuvres nouvelles remarquables ne retenaient plus chez les gardiens des traditions littéraires de notre scène.
Les sociétaires, lit-on dans le Dictionnaire des littératures, essayèrent d'introduire chez eux les procédés dramatiques et les personnages de la comédie italienne. Ils ne réussirent qu'à s'attirer la risée des petits théâtres de la Foire, et les satiriques se moquèrent de cette prétention des comédiens majestueux de Sa Majesté à devenir folâtres :
Ils feraient, ces messieurs-là,Si l'on voulait les en croire.Ils feraient, ces messieurs-là,Danser et Phèdre et Cinna.
La plaisanterie fut trouvée de mauvais goût, et les petits théâtres payèrent cher la concurrence qu'ils faisaient avec honneur et profit à la Comédie-Française.
Celle-ci, réclamant l'observation de son privilège, obtint du Parlement que plusieurs salles fussent abattues et soumit les autres à de sévères et parfois bizarres restrictions.
Citons un fait. Un montreur de marionnettes, Bertrand, voulut joindre des enfants à ses acteurs de bois ; les Comédiens français firent démolir sa baraque. Plus tard le directeur d'un théâtre forain voulut jouer sur ses tréteaux des farces dialoguées ; la toute puissante Comédie le réduisit aux monologues et aux pantomimes. Son rival imagina alors de mettre sur sa scène, à côté du personnage parlant, un personnage muet qui répondait par signes, ou bien cet acteur silencieux faisait mine de parler bas à son interlocuteur lequel répétait tout haut ce qu'on venait de lui conter à l'oreille. Le public malin ne comprenait pas toujours aisément l'intrigue des pièces ainsi représentées, mais il riait de la plaisante façon dont on évitait les foudres de la Comédie et cela suffisait à l'attirer.
Les comédiens furieux firent interdire alors aux acteurs des théâtres de foire de parler ni de chanter.
Les auteurs et les directeurs forains ne se découragèrent point pour si peu. Ils eurent recours à des écriteaux. Les écriteaux étaient des cartouches de toile roulés sur des bâtons, et sur lesquels des couplets étaient écrits en gros caractères, avec le nom du personnage qui aurait dû les chanter.
Au moment voulu, l'acteur déroulait sa toile et faisait lire au public ce qu'il n'avait pas droit de lui dire, ou bien l'écriteau descendait du cintre porté par des enfants vêtus en Amours qui le présentaient aux spectateurs. En même temps, l'orchestre jouait l'air du couplet et quelques compères répandus dans la salle, souvent le public tout entier, prenant le ton, chantaient ce qui était écrit. Les acteurs accompagnaient les paroles de jeux de physionomie comiques et de gestes appropriés.
Plus tard encore, sous le second Empire, on persécuta les cafés-concerts et on leur interdit de représenter quoi que ce fût ressemblant à une pièce et de faire porter à leurs chanteurs autre chose que des habits noirs. Mais, ô Liberté, il fallut enfin comprendre que, en dehors de toi, rien n'est ni raisonnable, ni utile, et depuis quinze ans que notre théâtre est complètement libre la Comédie-Française, en dépit, de concurrences sans nombre, n'en est pas moins restée le meilleur et le plus achalandé des théâtres.
Au XVIIIe siècle cependant la réputation et la prospérité de la Comédie étaient à leur apogée et indépendamment de l'éclat quelquefois orageux des oeuvres de Voltaire et de ses rivaux, elle se défendait mieux alors par le prestige de ses talents que par ses privilèges.
Cette époque, selon Régnier, est la plus brillante de l'histoire de la Comédie. De 1740 à 1780 on vit réunis sur la scène : Grandval, Lekain, Bellecour, Préville, Mole, Monvol, Brizard, Dugazon, les Duménil, les Clairon, les Dargoville, les Contât, et tant d'autres qui complétèrent cette admirable et presque fabuleuse réunion de talents. Au point de vue du jeu dramatique le XVIIIe siècle est le grand siècle du théâtre.
De tout temps les administrateurs ont été en proie à la critique; les reproches quon leur a adressés se ressemblent singulièrement et peuvent se résumer de la sorte. - Le Théâtre - Français no doit pas être régi au nom d'intérêts particuliers et dans un but purement spéculatif et commercial ; il est notre théâtre le plus ancien, le temple consacré à la conservation et à l'exposition permanente des richesses littéraires de la France qui a produit, sans contredit, les plus grands auteurs dramatiques. C'est presque d'une question de dignité nationale qu'il s'agit, attendu que l'Etat paye et subventionne les Comédiens français, non pour qu'ils fassent leurs propres affaires, mais celles de l'art dramatique dont ils sont les interprètes officiels.
Tels sont les griefs présentés par M. Eugène Laugier, historien de la Comédie, durant le règne de Louis-Philippe. Ne croirait-on pas qu'ils ont été adressés, hier, à l'administration de M. Perrin ? Ajoutons que les vieux amateurs criaient déjà à la décadence au temps de la Restauration, qui n'avait point ressuscité le théâtre tué durant les guerres du premier Empire. Un peu après 1830, il est vrai, après que les classiques eurent sifflé les drames immortels de Hugo, il se produisit une telle pénurie de productions dramatiques, que l'Académie, pour venir en aide à la Comédie, décida d'accorder, sur l'argent de M. Montyon, deux prix de dix mille francs à l'auteur « de la meilleure tragédie ou de la meilleure comédie » ; mais cet auteur ne parut point.
En ce temps-là, la Comédie fut sur le point de faire faillite; elle était assaillie de créanciers et possédait des dettes énormes.
Si le reproche de lucre adressé à M. Perrin reposait sur une prospérité sans précédent, il était donc bien enfantin, s'adressant à l'administration de 1830.
Peu à peu la Comédie se releva et mérita de nouveau la faveur du public ; ce fut une affaire de quelques années seulement et, de 1845 jusqu'à la fin de nos jours, la prospérité n'a point cessé d'aller croissant.
Il est à remarquer que, depuis le passage si éclatant, mais si rapide de Mlle Rachel, la Comédie-Française s'est soutenue moins par le prestige de quelques-unes de ces brillantes individualités que l'on appelle au théâtre des étoiles que par la distinction de l'ensemble. Jamais l'on a eu une exécution générale plus parfaite, un soin aussi grand de la mise en scène, un travail de répétitions aussi soutenu, un culte aussi fervent des traditions.
C'est par ces qualités que le sociétariat, si favorable à la dignité et aux intérêts des artistes, tend à se justifier aux yeux de l'art lui-même, dit M. Vapereau, en nous conservant au milieu de toutes nos crises littéraires une troupe et un répertoire classiques.
La Comédie-Française est régie par le décret rendu à Moscou le 15 octobre 1812 et le décret du 27 avril 1850. Voici, dans leur ensemble, et d'après un intéressant opuscule publié par M. Gaston Bonnefond, les statuts tels qu'ils découlent de ces décrets.
Le Théâtre-Français est placé sous la direction d'un administrateur nommé par le ministre des beaux-arts.
L'administrateur est chargé :
De présenter chaque année à l'approbation du ministre le budget du théâtre, dressé par le comité d'administration et soumis à l'examen de l'assemblée générale des sociétaires ;
De régler les dépenses, passer les marchés, etc.; de faire les engagements d'acteurs pensionnaires dont la durée n'excède pas une année ; de distribuer les rôles sans pouvoir imposer aux sociétaires des rôles en dehors de leur emploi ; de statuer définitivement sur les débuts et sur la formation du répertoire, ; de proposer, après avoir pris l'avis du comité d'administration, les admissions de sociétaires, le partage des bénéfices, etc., etc.
L'administrateur ne peut faire représenter aucune pièce n'ayant pas encore fait partie du répertoire, si elle n'a pas été admise par le comité.
Le Théâtre-Français auprès duquel l'autorité du gouvernement a été représentée, après les gentilshommes de la chambre du roi, par des commissaires impériaux ou royaux, n'a de directeur nommé par le ministre que depuis 1833.
Le premier qui en reçut le titre fut son ancien régisseur général, Jouslin de la Salle. Il eut pour successeur Vedel en 1838. La nomination de ces deux premiers directeurs se fit sur la présentation des sociétaires ; celle de M. Buloz, en 1847, donna lieu à des contestations pondant lesquelles survint la Révolution de Février. Le gouvernement républicain nomma M. Lockroy, en 1848, qui prit à peine possession de ses fonctions et, après un interrègne, fut remplacé par M. Arsène Houssaye en 1849. Celui-ci a eu pour successeur M. Empis en 1856, M. Ed. Thierry en 1859, M. Perrin en 1871 et M. Claretie en 1885.
M. Claretie est une intelligence; lettré, érudit même, très au courant de toutes choses, actif, connaissant son théâtre sur le bout du doigt, sympathique à tous, il mènera à bien sa direction. On peut-être certain qu'elle fera honneur à la Comédie et à lui-même.
Il est aidé dans sa tâche administrative par M. Bodinier, qui joint à ses qualités de secrétaire la plus parfaite amabilité.
Le savant M. Monval est chargé de la direction de la bibliothèque de la Comédie, autre musée dont nous regrettons de ne pouvoir parler.
Disons maintenant quelques mots des sociétaires et des acteurs.
Les artistes se divisent en artistes sociétaires, hommes et femmes, élus selon le mérite ou l'ancienneté par le conseil, et en artistes pensionnaires choisis dordinaire parmi les lauréats du Conservatoire.
Les sociétaires se partagent les bénéfices à parts entières ou à fractions de parts selon qu'il est décidé par le conseil, et les pensionnaires touchent des appointements fixes.
Les manuscrits des auteurs sont déposés au secrétariat et les pièces sont lues d'abord par un examinateur qui rédige un rapport. Après ce premier examen, l'auteur d'une pièce jugée intéressante est appelé à en faire lui-même lecture devant le comité d'administration composé de sociétaires et de l'administrateur. L'admission a lieu à la majorité des voix et l'oeuvre définitivement reçue entre en répétition.
Les droits d'auteurs pour chaque soirée sont de 15 % sur le produit brut et répartis selon le nombre d'actes joués dans la même soirée.
La Comédie-Française contient un véritable musée des plus curieux et des plus précieux. M. René Delorme a consacré à ce musée un livre très intéressant.
Dans le foyer des artistes de la Comédie- Française, dit cet écrivain érudit, dans le foyer des travestissements, dans la salle du comité, dans le cabinet de l'administrateur, dans les archives, dans toute la partie du théâtre où le public n'est pas admis, il y a un entassement prodigieux de portraits en pied, de médaillons, de tableaux de genre, de gravures, de dessins, de marbres, de terres cuites, de bronzes, de figurines en pâte tendre, qui forment, avec les statues et les bustes exposés dans le foyer public et dans les vestibules, une collection unique dont toutes les pièces se rattachent par quelque point à l'histoire de la maison de Molière.
Les objets qui composent ce musée ne sont pas seulement des documents précieux pour notre histoire dramatique ; ce sont des oeuvres d'art d'une grande valeur.
Parmi les toiles, il en est qui sont signées : Mignard, Largillière, de Troy, Van-Loo, Nattier, David, Gros, Gérard, Ingres, Delacroix, Girodet, Robert-Fleury, Geffroy, Isabey, Edouard Dubufe, Pollet.
Parmi les marbres, les terres cuites et les bronzes, il en est qui ont pour auteurs : Lemoyne, Houdon, Caffieri, d'Huez, Pajou, Foucou, Dantan, David d'Angers.
Et ces richesses sont pour ainsi dire inconnues!
La création de ce musée ne remonte pas au delà de la fin du siècle dernier et il serait curieux d'en suivre la formation ; mais ce récit nous entraînerait trop loin.
Il nous suffira, pour achever de le décrire, d'emprunter à Arsène Houssaye quelques lignes d'une admirable lettre qu'il écrivit à ce sujet pendant qu'il était administrateur de la Comédie.
Au foyer des acteurs, a dit le maître écrivain, on retrouve les comédiens de trois siècles, depuis Champmeslé jusqu'à Augustine Brohan. Celles qui vivent de la vie réelle sont-elles plus vivantes que celles qui vivent par la peinture et par la tradition? En entrant on salue du même coup de chapeau Mlle Rachel et Mlle Clairon. Elles sont toutes là, vivantes encore et souriantes sous le prisme éternellement gai de leurs folies d'autrefois, ces Dorines fortes en gueule de Molière, ces Martons presque sentimentales de Marivaux, ces Suzannes trop spirituelles de Beaumarchais et ces Victorines attendries de Sedaine ! Là elles jouent de l'éventail, ces grandes coquettes qui jouent du sceptre, depuis Mlle Molière jusqu'à Mlle Plessy ! Là, elles se dispersent sous les ramées, ces ingénues qui fuient l'amour parce qu'elles le cherchent, ces Psychés-Agnès, ces Galatées-Fanchettes qui prennent des leçons et qui en donnent. N'avez-vous pas reconnu ces pleureuses et ces furies, ces tempêtes incarnées, ces symboles illustres de la passion, qui s'appellent Champmeslé, Lecouvreur, Gaussin, Clairon, Rachel ?
Et, après avoir énuméré tous les portraits des grands artistes qui appartiennent à la maison de Molière, Houssaye passe en revue les toiles des maîtres de notre littérature dramatique. Ils sont maintenant passés au rang de demi-dieux, dit-il. Toutefois Racine évoque plutôt les pompes de Versailles que les fêtes de l'hôtel de Bourgogne ! Voltaire, encore couronné de sa jeunesse, ne se soucie pas des couronnes d'Irène ! Regnard a l'air de se rappeler son dernier coup de lansquenet. Molière pense à sa femme, Dufresny à sa blanchisseuse, et Marivaux à Mlle Sylvia. Crébillon, drapé à la romaine, se croit sur le forum, et Ducis, couvert de fourrures, traverse, le front nuageux, le pays d'Hamlet et de Macbeth. Seul, le vieux Pierre Corneille est tout à sa Comédie.
Cette énumération colorée, superbe, se termine par un éclatant éloge des comédiens et des comédiennes qu'on voit tous les soirs, vêtus de leur plus beaux habits, pariant un idéal langage, obligés à l'urbanité et de l'urbanité tirant un moyen de domination. Ils ont été patronnés devant le tribunal des siècles par les plus éloquents plaidoyers, et comment réfuter ces avocats incomparables : Aristophane, Plaute, Shakespeare, Corneille, Molière, Voltaire, Victor Hugo.
Après avoir, pour nos lecteurs, entr'ouvert la porte de ce musée unique au monde, incomparable, et pourtant si inconnu, et qu'on a justement appelé un Vatican profane; après avoir rendu hommage à M. Arsène Houssaye qui consacra tous ses efforts à l'enrichir, nous reproduisons le voeu de M. Delorme demandant qu'on s'occupe de l'avenir de cette merveilleuse galerie.
La Comédie s'est fait une règle de n'admettre dans son foyer que ces portraits d'auteurs ou d'acteurs décédés. Sans doute l'honneur dont on est si ménager a plus de prix ; mais ne pourrait- on pas, dans l'hypothèse où l'on obtiendrait un peu plus de place, ouvrir une salle nouvelle, exclusivement consacrée aux acteurs et aux auteurs contemporains, un petit Musée du Luxembourg, d'où les portraits seraient enlevés à la mort de l'artiste ou de l'écrivain, pour passer dans le Louvre définitif, dans le grand foyer ? La manière dont se recrutent les sociétaires de la Comédie, le soin avec lequel les auteurs sont triés parmi les meilleurs, ne les rendent-ils pas tous dignes de l'honneur d'avoir leur image auprès de celles de leurs devanciers ?
Il n'est point douteux que cette manière de faire vaudrait à la Comédie des dons importants. MM. Régnier, Brossant, Got, Delaunay, Coquelin, Mme Sarah Berhnardt, Mlle Croizette, Mlle Reichemberg, pour ne citer que quelques noms contemporains, ont été souvent représentés sur la toile ou dans le marbre par des artistes d'une grande valeur.
Ils désigneraient eux-mêmes les oeuvres les meilleures. A ce souhait excellent ajoutons-en un autre : celui de rendre accessible au public les salles contenant toutes ces merveilles. Sans doute le foyer public et le vestibule de la Comédie contiennent des oeuvres hors ligne qu'il est inutile de citer puisque tout le monde les connaît. Mais le reste, c'est-à-dire ce qu'il a de plus précieux, est en quelque sorte caché à l'admiration et c'est dommage.