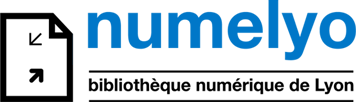Causerie Le bal des Etudiants
Le bal des Etudiants est si populaire parmi nous, tout Lyon se presse si joyeusement à cette soirée unique où chacun veut prendre sa part de plaisirs qu'ennoblit la Charité, que le Progrès illustré a cru devoir lui consacrer les gravures de ce numéro exceptionnel.
Pour cette fois aussi, je cède la place de la causerie à notre confrère du Progrès, M. J . Grobon. Il parlera à nos lecteurs du bel aspect et de l'entrain de la fête et décrira avec compétence pour nos lectrices les costumes charmants et spirituels portés par les jolies femmes inscrites au concours d'élégance et de beauté qui est de tradition a u bal des Etudiants.
Le bal des Etudiants prend chaque année les proportions d'un gros événement lyonnais, et l'on pourrait même dire sans trop d'exagération qu'il est devenu une manière d'institution, mais une institution qui allie si à propos la gaîté et la bienfaisance que tout le monde y applaudit. C'est aussi une petite révolution qui se produit dans les milieux les plus divers de notre bonne ville de Lyon, lorsqu'apparaissent dans les journaux les premières notes annonçant la fête de Messieurs les escholiers et les surprises qu'elle réserve. On ne saurait croire combien d'imaginations mettent en éveil ces mots magiques : « Bal des Etudiants ». A l'atelier, en tourmentant la pédale de la machine à coudre, derrière la vitrine où elles chiffonnent les fleurs que porteront les belles dames, Les petites ouvrières et les coquettes modistes en rêvent et se chuchottent bas à l'oreille que cela doit être bien amusant un bal d'étudiants.
Dans les salons les plus collet-monté ce bal fait aussi l'objet des conversations à l'heure du five o'clock et si l'on soulevait les masques de quelques-uns des dominos mystérieux qui braquent les lorgnettes du haut des loges, ou des premières galeries, on reconnaîtrait plus d'une grande dame dont le nom sonne bien dans ce que l'on appelle le monde comme il faut.
Chez la modeste tailleuse où se confectionne le simple costume de calicot comme chez la grande « faiseuse » où se composent les riches travestis, l'approche de cette soirée met tout en l'air : on taille, on ajuste, on drape les velours chatoyants et les salins qui craquent, et si quelque pli survient qui nuit au « galbe » du corsage le ciseau coupe et recoupe, l'aiguille court rapide - et si elles piquent leurs doigts mignons les couturières s'en consolent en pensant que le costume qui leur donne tant de peines obtiendra peut-être le premier prix au concours.
Puis enfin quand arrive la soirée attendue, quand les rampes s'illuminent et qu'au fronton du théâtre, flamboient ces trois lettres de feu « Bal », la légion des curieux, et des pauvres diables aussi, se précipite avide de voir les masques qui vont descendre des voitures et de contempler les heureux que des valets galonnés conduisent, jusqu'à l'entrée de cette fête qui apparaît déjà comme une féerie.
Au dedans les costumes les plus variés se mêlent, formant, un tumultueux contraste, les plus beaux spécimens de notre grande industrie lyonnaise apparaissent dans tout l'éclat de leurs éblouissantes couleurs : l'or, le rubis, l'émeraude, la turquoise, les saphirs, l'améthyste scintillent sous les lumières et bientôt cette foule étrangement bigarrée, jaune, ronge, vert, azur, bleu et violet, va s'ébranler aux accords d'un orchestre incomparable offrant à l'oeil du spectateur le spectacle magique d'une joyeuse apothéose.
Si nous pénétrions plus intimement dans la fête il y aurait longuement matière à philosopher, voire à potiner, mais nous n'arracherons aucun masque, nous ne dirons rien des intrigues qui se nouent et se dénouent pas plus que des baisers furtifs que des cavaliers audacieux déposent au passage, sur les blanches épaules d'«honnestes dames » peu farouches ; le bruit de ces baisers est d'ailleurs si léger, si vite emporté par les sonorités triomphales de l'orchestre, qu'il reste inaperçu. Et puis, qu'importe ! C'est pour les pauvres et cela excuse bien quelques privautés, quelques accrocs à l'ordinaire rigorisme.
La fête des escholiers a conquis maintenant droit de cité à Lyon ; à ce titre, il nous a paru intéressant d'en rechercher les origines.
C'est en 1877 qu'elle naquit. La Charité, bien entendu, fut sa marraine. La population ouvrière de la Croix-Rousse subissait une terrible crise de chômage ; depuis plusieurs mois les battants des métiers avaient cessé leurs « tic-tac », le joyeux refrain du canut était tombé de ses lèvres et la misère s'était assise à son foyer apportant avec elle son triste contingent de souffrances.
Un cri de pitié secoua Lyon, la ville bienfaisante par excellence. On organisa des représentations théâtrales, on fit des quêtes, des comités de secours se formèrent pour venir en aide aux plus nécessiteux. En pareille circonstance, les Etudiants ne voulurent pas être les derniers à apporter leur obole aux miséreux. Vite, ils songèrent à une fête, et cette fête organisée par des jeunes gens ne pouvait être qu'un bal - un bal où l'on s'amuserait ferme, où dans l'allégresse du plaisir les porte-monnaie s'ouvriraient comme d'eux-mêmes et où la mousse blonde du champagne se changerait on louis d'or tombant dans la sébille du pauvre.
Ils ne se trompaient pas messieurs les Etudiants et leur premier bal qui se donna à l'Alcazar fut un colossal succès ; les élèves des Facultés catholiques eux-mêmes y prirent part; le public s'y rendit en masse; les promenoirs du vaste palais mauresque regorgèrent ; on dut refuser du monde. Le maëstro Lamothe, alors le roi de la danse, dirigeait l'orchestre; la recette dépassa toutes les espérances, et le triomphe fut si complet que la presse fut unanime- à conseiller aux étudiants de recommencer leur bal chaque année.
M. Girrane, dessinateur du Progrès illustré, a retracé, en des croquis spirituels et d'une parfaite exactitude, les diverses étapes du bal des Etudiants. On les trouvera à l'intérieur du journal. Le premier dessin - à gauche en haut - nous conduit à l'intérieur de l'Alcazar, en 1877, au moment où l'animation est portée à son comble par une bande joyeuse s'élançant dans la plus endiablée des farandoles.
En 1878, le bal des Etudiants n'eut pas lieu, nous ne saurions dire pourquoi. Nous le retrouvons l'année suivante aux Folies-Bergère s'affirmant avec une vigueur souriante de la plus belle venue. La salle de l'avenue de Noailles possédait, alors deux groupes qui en complétaient très heureusement l'ornementation. D'un côté de la scène on voyait le groupe de la Danse de Carpaux, copié sur celui de l'Opéra de Paris, et de l'autre, la Guerre, la puissante composition dont Rude a orné l'Arc de triomphe des Champs-Elysées.
En 1880, l'enfant a grandi ; il est maintenant, dans toute sa force et il lui faut pour s'ébattre de vastes espaces; c'est ainsi qu'il vient élire domicile au Théâtre-Bellecour. Lorsqu'on sut, que le bal se donnerait là, une émotion agita toutes les élégantes lyonnaises ; elles pensèrent avec raison que leurs toilettes ressortiraient plus brillantes dans la somptueuse salle aux éclatantes dorures, et elles se dirent qu'à un tel cadre il fallait de superbes tableaux; toutes les couturières furent mises à contribution ; on fit appel aux dessinateurs de Lyon et de Paris, et Grévin, d'illustre mémoire, dut tailler son meilleur crayon.
L'an de grâce 1881 voit le bal des Etudiants dans toute sa splendeur. Pour lui donner un nouvel essor, la Commission appela Métra, le maëstro de la valse troublante et alanguie. Les costumes, celte année, furent merveilleux. On remarqua surtout une Folie Polichinelle, un Carabinier d'Offenbach, une Arlequine, un Incroyable, un clown jouant de la clarinette, et une Feuille de vigne, etc.
Le « clou » du bal fut le quadrille des Mirlitons dansé sur la scène. Le peintre Louis Guy, qui repose maintenant à Loyasse attendant le monument que ses amis lui préparent, avait dessiné le programme. On n'a pas refait mieux.
La Commission du bal est entourée chaque année de précieux collaborateurs; à côté des charmantes artistes des théâtres, il faut citer Jean Sarrazin. Sa tête et sa personnalité sont trop connues pour que nous insistions : on le verra croqué sous tous ses aspects : en Homère inspiré, accordant sa lyre chez les lions de Pezon, à la brasserie (d'zolives, messieurs et dames!), lisant ses vers assis sur une pile de volumes de Hugo, Musset, Lamartine, Soulary, etc. Il est si ressemblant qu'il s'est reconnu lui-même et qu'il a approuvé le croquis :
Je suis bon diable, un peu poèteEt grand prodigue de ma tête.
Au milieu d'un nuage de notes de musique sur lequel leurs têtes se détachent, comme d'une auréole on reconnaîtra les chefs d'orchestre qui, tour à tour, ont conduit le bal des étudiants. Antony Lamothe, l'aîné, l'aïeul, celui qui vingt fois, trente fois entraîna de son archet vainqueur des générations entières de Lyonnais ; Métra, qui dort son dernier sommeil à Montparnasse, après avoir dormi quelque fois en conduisant ses musiciens ; Fahrbach, le Hongrois langoureux, dont le jeu trop mélancolique s'accorda mal avec le tempérament des valseurs de Bellecour; Arban, le fils de l'artificier, mort, comme Métra, après avoir dirigé si brillamment les fameux bals de l'Opéra, et enfin, Alexandre Luigini, qui prouva qu'il savait déchaîner les entrechats et les tourbillons de la danse aussi bien que conduire les oeuvres de Meyerbeer, de Gounod ou de Wagner.
Entre toutes les innovations heureuses apportées pour rendre le bal encore plus attrayant, il faut parler de la création des Concours de costumes et de beauté.
C'est en 1886, que pour la première fois, les élégantes eurent à comparaître devant le jury qui décernerait la palme à la plus belle. Le portrait des aimables jeunes personnes qui triomphèrent en ce tournoi galant forme dans notre dessin comme une petite galerie de la beauté lyonnaise.
Tous les costumes et tous les dessins exécutés par M. Girrane l'ont été d'après des documents originaux et des photographies fournies par MM. Victoire, rue St-Pierre; Héron, successeur de Chardonnet, place Bellecour; Brotonnière et Joguet frères, place des Jacobins ; Alexandre Sage, rue Terme.
Nous interrompons jusqu'au prochain numéro lhistorique du bal des Etudiants pour donner aujourd'hui un compte rendu de celui de 1893. Nous reprendrons la suite la semaine prochaine, avec la continuation des portraits, espérant que les Lyonnais revivront avec plaisir ces souvenirs de jeunesse et de gaîté.
Nous voici donc maintenant dans la nuit du 4 au 5 mars 1893, au Grand-Théâtre, où le bal des escholiers a émigré laissant Bellecour à la pioche des démolisseurs. Au moment où nous entrons, la fête est dans tout son entrain. La foule des cavaliers et des travestis remplit la salle, la scène et le foyer. Deux rampes d'escaliers partant des premières galeries, et drapées de velours grenat, conduisent les arrivants au parterre improvisé où l'on danse. Malgré soi, avant de se mêler à la foule grouillante et pressée, on est retenu un instant, curieux d'admirer du haut des premières ce spectacle toujours nouveau, d'où monte une rumeur étrange et capiteuse faite du frou-frou des étoffes et du mouvement des danseurs.
Il fait chaud, très chaud ; mais on a songé à tout, et les buffets se dressent abondamment pourvus de champagne et de rafraîchissements variés. Les artistes de nos théâtres, qui en ont la garde, pour se rendre plus séduisantes et augmentera recette, ont arboré des toilettes, exquises :
Mme Verheyden porte le superbe costume de Rosine du Barbier de Sévile, jupe en satin vieux rose, corsage vert olive, garni de dentelles noires ; de sa luxuriante chevelure sort, comme un diadème, le grand peigne d'écaillé des fières Andalouses. Cet ajustement fait à sa beauté un cadre digne d'elle.
Mlle Esquilar avec une toilette du meilleur goût, a symbolisé le tournesol, la fleur éclatante que tout le monde connaît sous le nom de soleil; la robe est en tulle et satin noir; la gracieuse artiste s'est coiffée d'un double soleil qui fait ressortir l'éclat de ses grands yeux noirs.
Mmes Fierons et Doux perlent toutes deux le costume de Polichinelle inauguré par Mlle Samé dans le Cadeau de Noce : robe de satin encre de Chine, pailletée d'or, avec empiècement de gaze d'or, couverte de perles multicolores, corsage orné d'aiguillettes de perles fines ; chapeau polichinelle en satin, pailleté et galonné, orné de plumes noires.
Mme Blanche Ollivier, des Célestins, a endossé le costume d'arlequin qui sied très bien à son entrain ; elle fait d'excellentes recettes ;
Mlle Monge, première danseuse, portait une toilette de surah rose morte, garnie de plumes même nuance ;
Mlle Valker, était en robe canari, piquée d'oiseaux noirs ;
Mmes Mondaud, Collet-Mathieu, Sonnet, - bien jolie et très fêtée Mlle Sonnet Tosi, Monge soeurs, portent aussi de très élégantes toilettes.
Si nous voulons admirer quelques-uns des mille travestis qui se heurtent et se coudoient dans le plus extraordinaire des mélanges il nous faut remonter un instant, aux premières galeries. En braquant notre jumelle nous voyons successivement défiler :
Un beau Bébé Directoire, robe bleue pâle, ceinture soie bleue d'azur, ses cheveux blonds bouclés encadrent délicieusement son visage, masqué bien entendu ; Bébé, pour être plus nature, tient un biberon à la main ;
Un autre Bébé Directoire : celui-ci, tout, en soie rose et dentelles crème est coiffé d'une immense capote rose avec mentonnières même nuance; Bébé n'a pas de biberon, il joue au ballon ;
Une Nuit, avec croissants d'or sur les épaules ; coiffée d'un diadème ;
Le roi Gunther, coiffé d'un casque d'acier orné des ailes de faucon, les épaules recouvertes d'un manteau fait d'une belle peau d'ours noir. Le rude Gunther est accompagné de son épouse toute vêtue de peau de chèvre blanche. Une Elégante symbolise une vigne vierge, costume très original et dont la composition ne manque pas d'ironie en ce milieu.
Les masques défilent, les couples se rapprochent; M. Couard qui a remplacé un instant Luigini, lève sa baguette ; une valse va commencer, hâtons-nous de terminer notre inspection. Voici encore :
Une Sapho, en satin noir, corsage garni de lilas naturel ; un Soleil, la coiffure est formée par la large fleur d'or recouvrant le minois éveillé d'une jolie femme; une Clownesse dont la perruque dessine trois cornes ; une Nuit étoilée avec chapeau en forme de croissant noir et or ; un Beau Nicolas, avec son « brûle-gueule » à la bouche ; un costume Directoire, en satin cerise plissé du haut en lias ; un autre, de la même époque, mauve garni de violettes de Parme ; deux Clowns orientaux en salin vert; la Bande d'Oies, précédée d'une Oie ouvrant ses ailes et portant bannière dans le dos; derrière, suivent une quinzaine de clowns blancs, bleus et noirs, coiffés du tube microscopique; l'un d'eux lire des accords discordants d'une trompette.
Pour terminer cette série : Une adorable Colombe, maillot crème avec traîne de même nuance, corsage orné de plumes d'autruche blanches. Dans la coiffure, et... au bas du dos, sont piquées deux colombes. Une Arlequine-Polka, pantalon et corsage de satin or bouffant, veste à crevés noirs, collerette de gaze noire, perruque blonde surmontée d'un mignon chapeau d'arlequin.
Ces deux travestis ont obtenu, le premier, le, prix de beauté, et le second, le prix de costume. Il y aurait encore bien des toilettes à citer, mais les pages entières de ce journal n'y suffiraient pas. Il ne faut cependant pas quitter le Grand- Théâtre sans admirer les loges que plusieurs élégantes ont décorées à leurs frais. L'une d'elles était un véritable nid de fleurs et évoquait presque le souvenir de la grotte de Calypso ; partout grimpaient sous un fouillis de guirlandes, des violettes, des roses, des camélias et des mimosas. Le jury a accordé le premier prix à la propriétaire, de cette loge.
Il est, six heures du matin, le tambour sonne la retraite, les derniers danseurs, infatigables et, enragés, s'en vont à contre-coeur; ils resteraient, encore si l'on n'éteignait pas les lustres et si la voix des gardiens de la paix ne leur criait : C'est fini messieurs et dames, on va éteindre !