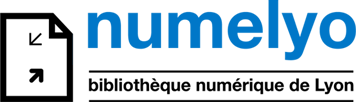Causerie. Lyon, le 4 janvier 1893
Une revue vient de publier un travail assez curieux sur les ténors, ces oiseaux rares, brillants et coûteux qui excitent de si enthousiastes transports parmi les habitués des quatrièmes de notre théâtre lyrique. Il résulte de ce document que les marchands dut de poitrine ne naissent pas dans les pays de gros mangeurs et de gros buveurs, ni dans les contrées où l'on se nourrit surtout de viandes et de poissons. La statistique cause quelquefois de ces surprises. Personne n'aurait cru que les filets de boeuf ou le merlan eussent une influence si fâcheuse sur la production des Fernand et des Raoul. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais voilà ce que nous enseignent les dernières investigations de la science. Il est de fait que dans le Nord où l'on boit, sec et où la nourriture est substantielle, de même que dans le midi des bords de la Méditerranée où le mets national est la bouillabaisse, c'est-à-dire la soupe de poisson, il naît fort peu de ténors. La plupart nous viennent de Toulouse et de la région pyrénéenne, où l'alimentation frugale est en effet conforme aux données dont je viens de parler plus haut.
Mais ce que les savants n'ont pas encore découvert, c'est la faculté mystérieuse qui donne à la voix sa puissance, son timbre et son éclat. L'étude micrographique des cordes vocales ne nous a pas expliqué comment il se fait que les uns aient une voix étendue et charmeuse, tandis que les autres font penser aux portes mal graissées et aux cordes à puits. Il y a là sans doute un caprice de la nature analogue à celui qui dote certains visages d'un nez grec et de larges yeux, alors que tant de faces humaines sont déshonorées par un appendice nasal en forme de trompe, surmonté d'yeux en trous de vrille. Question de guigne ou de veine, suivant les bonnes ou mauvaises dispositions du hasard qui préside aux destinées de chacun.
Quoiqu'il en soit, il est agréable de venir au monde avec un larynx susceptible de s'attaquer victorieusement au septuor des Huguenots. Outre qu'on y gagne des appointements d'ambassadeur, les ténors jouissent en ce temps de cabotinage d'un prestige universel. Dans les villes de province particulièrement, leur renommée dépasse de beaucoup toutes les gloires locales. Notre ancien imprésario, M. Campo- Casso, aujourd'hui codirecteur de l'Opéra, qui est un conteur coloré et plein de verve, me disait un jour à ce sujet un mot bien typique. C'était à Marseille. Un Parisien en voyage rencontre un ancien ami, Marseillais de la Cannebière, qu'il n'avait pas vu depuis de longues années. Oui, mon cher, lui dit l'homme du Midi - avec son exubérance convaincue si bien servie par l'accent local - j'ai, fait du chemin depuis que je ne vous ai vu ! J'ai maintenant une brillante situation et surtout des relations superbes. Tenez, tel que vous me voyez, je connais le TEUNOR!!
Robert le Diable vient de reparaître sur l'affiche de notre Grand-Théâtre, et comme d'ordinaire, toutes les fois que le vieux maître Boudouresque, toujours jeune par le talent, joue le rôle de Bertram, l'opéra de Meyerbeer fait de copieuses recettes. Il faut dire qu'il est interprété à miracle par Mme Fierens et Escalaïs. Tout de même, c'est encore Boudouresque qui attire le public. Bertram sans lui n'est plus Bertram. Il s'est si profondément incarné en son personnage, il en rond si puissamment le caractère satanique et les angoisses paternelles que le spectateur empoigné oublie tout ce que le livret de Robert a de peu digestible, aussi bien que le suranné et le banal en certaines pages de cette partition inégale.
N'oublions pas que Robert date du milieu du règne de Louis-Philippe. En ce temps lointain où le romantisme s'était emparé de l'art en maître souverain, une telle oeuvre devait paraître admirable de tous points. Elle produisit en effet une impression énorme. C'était dans les salons à la mode le sujet de toutes les conversations. Philibert Audebrand rapporté à ce propos, dans ses Petits Mémoires du XIXe siècle, une historiette assez piquante dont Méry fut le héros. C'était chez madame de Girardin, à une soirée intime où assistait une élite de gens distingués. On parlait de la scène de Robert le Diable où les nonnes, livides fantômes, soulèvent la pierre de leurs sépulcres à la voix de Bertram : Ça fait froid dans le dos, dit une jolie femme. On dirait le jugement dernier!
Le jugement dernier, répliqua M. Villemain, vous croyez à cette fable?
Certainement, dit Méry, intervenant à son tour, et j'en ai la si claire compréhension que je vois d'avance ce qui se passera ce jour là.
Alors, mon ami, ajouta madame de Girardin, vous allez nous faire le plaisir de nous raconter vos impressions.
Méry était, comme on sait, un merveilleux improvisateur. Il accepta sans se faire prier, à condition qu'on éteindrait les bougies et que quelqu'un l'accompagnerait sur le piano. Au bout de quelques instants, toutes les lumières s'éteignirent, et tandis que le piano tenu par un grand artiste plaquait des accords sinistres, Méry commença un effrayant récit, une infernale vision plus terrible que les plus noires pages du Dante. Quand il eût fini, tous les assistants en avaient le frisson. Plusieurs jeunes femmes s'évanouirent d'effroi. Et M. Villemain lui-même dût reconnaître qu'il se pourrait bien en effet que l'enfer existât.
Boudouresque remporte auprès de notre public un succès du même genre. Non pas qu'il nous fasse croire à l'enfer. Il y a beau temps que ce mythe symbolique est définitivement classé dans le magasin des accessoires inutiles. Mais le prestige de son talent est tel, qu'il donne de la grandeur et de la vie à des scènes qui font sourire, quand elles sont traduites par un autre. Et c'est déjà un assez beau triomphe.